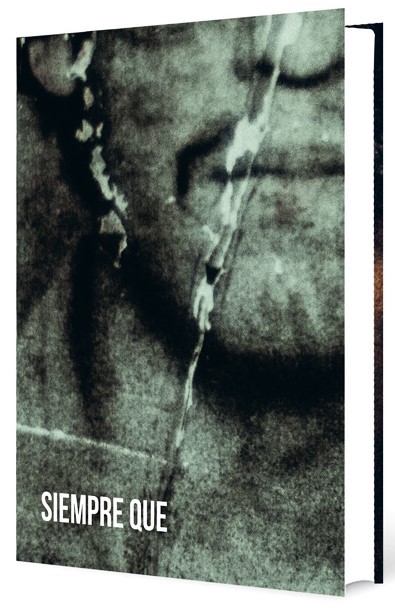Yair et moi étions sur l’azotea (toit) du bloc 11, la brume enveloppait Caracas, la rumeur folle de la ville ressemblait à un chant funèbre. C’était une balle dans mon cœur. La conscience de sa propre fin avait quelque chose de terrible et sublime à la fois. Tout était dit. L’urgence de la vie, la fascination pour la mort, l’effondrement du pays.
L’extrême violence et l’absurdité de la situation donnait l’impression que la vie n’était qu’un jeu.
Je me rappelais deux jours plus tôt la gallina (arène pour combats de coqs). L’odeur du sang mélangée au rhum et la sueur, les cris de rage, l’excitation de chaque homme. Une transe impalpable enivrait l’arène. Comme si nous étions tous fous. Comme si le sang, la mort et le pouvoir rendaient plus vivants.
L’énergie chaotique de la ville raisonnait dans chaque combat telle une danse qui se déploie, qui reste et pleure impuissante.
Un mois plus tard, Yair fut abattu. Il avait 27 ans.
Mes errances en Amérique latine furent traversées par d’autres rencontres saisissantes. Comme ces coqs de combats, je voyais des êtres danser et s’accrocher au désordre. J’y retrouvais à chaque fois cette même sensualité insolente, comme une furieuse provocation, comme un cri d’adolescent amusé par le danger, condamné et libre.